XXe-XXIe siècles
-
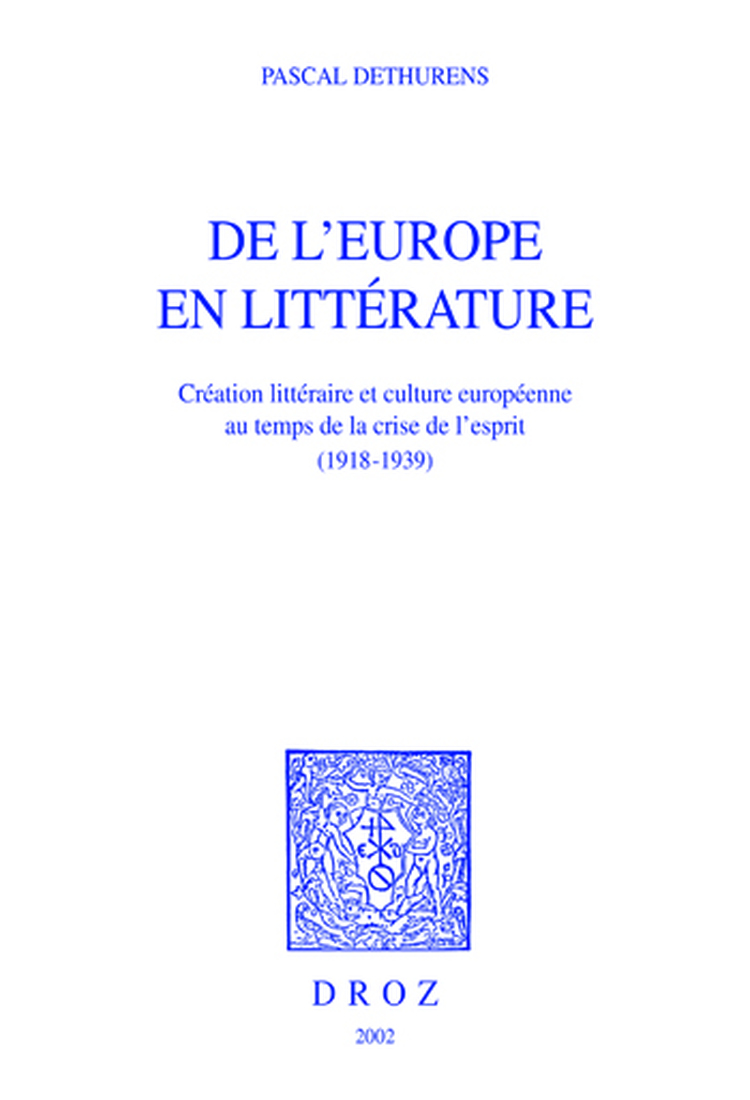
«Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles». Tel se donne à lire, selon la formule célèbre et désenchantée de Valéry, l’acte de naissance de l’Europe dans la littérature du XXe siècle. Pour quiconque s’interroge aujourd’hui sur la définition de la «littérature européenne» et, plus largement, sur l’identité de la «culture européenne», force est de constater la complexité des questions soulevées. De quoi parle-t-on au juste lorsque, à l’aube de la modernité, l’Europe – l’Europe comme mythe, comme idée, comme thème ou comme figure – est soumise à examen? S’agit-il toujours de la même réalité, suivant qu’on la conçoive à la façon polémique des surréalistes en France ou à la manière apocalyptique des grands poètes (T. S. Eliot, W. B. Yeats, Pessõa, Séféris, D’Annunzio, García Lorca, Rilke)? Que nous apprennent de notre culture, tout au long de l’entre-deux-guerres, les romanciers les plus subtils (Proust, Kafka, Svevo, Mann, Hesse, Broch, Musil, Joyce, Huxley ou Witkiewicz), les auteurs dramatiques les plus audacieux (Claudel, Hofmannsthal, Pirandello) et les théoriciens les plus novateurs (de Spengler à Freud)? Voilà l’enjeu de ce livre: partir à la recherche de l’Europe en littérature pour, textes à l’appui, parvenir à définir une nouvelle poétique de la culture.
-
-

Fictions de l’ipséité analyse les œuvres de Beckett, Hesse, Kafka, Musil, Proust et Woolf à la lumière de l’«autobiographie fictive» imaginée par Hesse: sous le masque des personnages inventés, ces auteurs remodèlent leur moi et recomposent leur vie en les transposant dans une représentation mythique de Soi. Par la mise en scène de situations extrêmes (exil, errance, échec, maladie, mort), par le recours à la figuration théâtrale, picturale et musicale, la fiction procure une représentation appropriée de ce Soi inventé, instance insaisissable et quasi divinisée de l’excès. Il fallait cette approche nouvelle d’œuvres majeures pour mettre en évidence la logique qui préside à la personnalité et aux aventures de leurs héros. L’indétermination, l’anonymat, les formes de rupture et de marginalité (fuite, folie, transgression, avilissement) récurrentes dans ces œuvres sont en effet interprétés comme l’attitude de soustraction et de négation, grâce à laquelle, paradoxalement, le héros – et à travers lui son auteur – s’érige en un Moi superlatif.
-
-
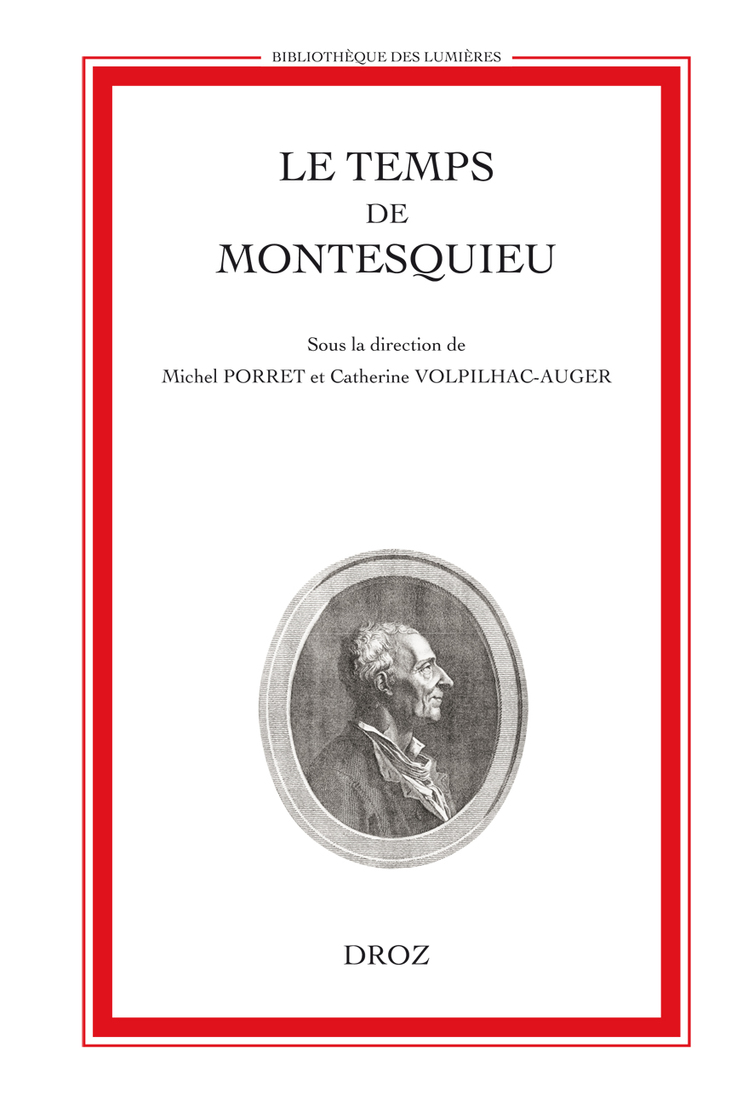
Le Temps de Montesquieu réunit une trentaine de communications originales présentées à l’Université de Genève en novembre 1998 au Colloque international célébrant le 250e anniversaire de l’édition chez l’imprimeur genevois Barrilot et fils de L’Esprit des lois. Traqué par les censeurs, ce best-seller des Lumières s’annonça aussitôt comme l’œuvre majeure de Montesquieu. Cette somme juridique et philosophique allait marquer le siècle, susciter un débat sur la légitimité des institutions politiques et devenir un classique du libéralisme dont la leçon reste d’actualité pour penser le droit ou l’Etat. Le Temps de Montesquieu replace l’histoire éditoriale de l’Esprit des lois dans son contexte genevois et européen, analyse la culture politique et juridique qui le nourrit, questionne la philosophie de l’histoire de son auteur qu’inquiète l’expérience de l’absolutisme de droit divin, en évoque la réception dans la République des lettres européenne. Donnant sens aux travaux et à l’héritage intellectuel du philosophe de La Brède, cet ouvrage collectif éclaire la modernité des Lumières, qu’à sa manière il a forgée.
Les éditeurs du Temps de Montesquieu, Michel Porret et Catherine Volpilhac-Auger, enseignent respectivement l’histoire moderne (Université de Genève) et la littérature française (Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences humaines, Lyon). Auteurs de nombreuses publications portant sur les Lumières, ils sont notamment co-rédacteurs des Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau et de la Revue Montesquieu.
-
-
-
-

Après Rome, Paris ou Berlin, New York s'est imposé comme véritable mythe littéraire. Par-delà les œuvres fondatrices (Manhattan Transfer de Dos Passos, Amerika de Kafka, New York de Morand et Voyage au bout de la nuit de Céline), de nombreux romanciers français se sont également emparés de ce mythe, profitant de sa fluidité pour se l'approprier, le remodeler, le déformer. C'est l'ensemble de cette production, de 1945 à nos jours, que l'on se propose de parcourir ici. Textes encore très proches de l'essai, récits d'aventures à coloration exotique, genres et figures hérités de la tradition transposés sur cette nouvelle scène, imitations de la paralittérature américaine, exploration de toutes les formes de marginalité urbaine, manipulations d'un matériau poétique avec le Nouveau Roman, la littérature française offre, on le voit, un vaste éventail. Au sein de cette variété, souvent le référent urbain cède le pas à un répertoire new-yorkais, tant littéraire qu'iconographique, enrichi des apports du cinéma, de la bande dessinée et des arts plastiques. New York s'ouvre à toutes les formes d'écritures romanesques, à toutes les expériences littéraires. Chaos mythique de la modernité, cette capitale devient l'horizon fabuleux du roman français.
-
Dans cette étude, Jérôme Meizoz montre comment durant l’entre-deux guerres, dans l’aire francophone, se met en place un roman parlant. Cette innovation trop peu remarquée jusqu’ici, engage une voie capitale du roman au XXe siècle : le récit s’y fait passer pour un bouche-à-oreille immédiat et parvient à occulter la médiation de l’écrit. Par le biais des nouvelles poétiques de l’oral, les romanciers, de Louis-Ferdinand Céline à Louis Aragon, de Jean Giono à Raymond Queneau, Blaise Cendrars, C.F. Ramuz ou Henry Poulaille, tiennent sur la langue littéraire un discours critique, contre l’étroitesse normative de la grammaire traditionnelle. Le récit oralisé va ainsi susciter, durant deux décennies, de vifs débats entre écrivains et critiques, mais aussi entre grammairiens (Thérive, Hermant), linguistes (Bally, Vendryès, Frei) et pédagogues (Freinet).